Yoga, Autisme et TDAH : bien enseigner avec la sensorialité
Yoga, Autisme et TDAH : derrière ces trois mots sonnant froidement se cache une formidable aventure humaine.
Aujourd’hui, je vous propose d’y ajouter toute la chaleur et la générosité de Jenny Leclerc, que j’ai eu la joie de recevoir en interview à l’occasion de la sortie de son livre éponyme. Attention, coup de cœur. Jenny, c’est la résilience incarnée !

Avant tout, Jenny est maman de deux enfants diagnostiqués autiste et TDAH. Dans cette épreuve, le yoga a d’abord été pour elle une bouée de sauvetage personnelle. Je profite de ces lignes pour adresser tout mon soutien aux familles concernées qui me liront peut-être.
Jenny est ensuite devenue professeure de yoga, formée auprès de Maryse Lehoux, qui est également co-autrice de ce livre et qui est bien connue en France pour son univers Diva Yoga. Naturellement, une question s’est imposée à Jenny : comment le yoga pouvait-il aider ses filles ?
Au fil de notre échange, elle évoque le yoga des 8 sens, ou yoga de la sensorialité : une approche essentielle pour mieux comprendre les comportements des enfants à besoins particuliers et les accompagner avec bienveillance.
Son message est simple et puissant : le yoga peut soutenir les familles touchées par la neuroatypie, apaiser les enfants comme leurs parents et renforcer le lien familial, là où le quotidien, les comportements dits à problèmes et le regard sociétal conduisent souvent à l’épuisement.
Chaque graine semée compte… et je suis heureuse de pouvoir, à mon tour, en semer une à travers cette interview.
Belle écoute et belle découverte !
Retrouvez Jenny Leclerc sur son site web Yoga Nature et Santé. Jenny propose des cours parents / enfants en Normandie, à côté d’Evreux. Elle accompagne également les familles en ligne.
Jenny Leclerc : De maman épuisée à prof de yoga investie et passionnée
Avant d’aborder les questions concrètes d’enseignement, j’ai d’abord demandé à Jenny si elle acceptait de revenir sur son parcours et sur les diagnostics de ses filles qui l’ont conduite vers cette approche du yoga sensoriel.
Jenny : Bonjour Muriel. On a tous nos bagages, on a tous notre histoire. Et je n’avais pas encore le yoga dans ma vie. Et puis l’autisme, au début, on ne le savait pas. Le diagnostic est arrivé après, comme un pavé dans la mare.
Le yoga a vraiment été une ressource pour moi en tant que parent, pour me sentir mieux. Et puis, peu à peu, il y a eu cette envie d’aller plus loin et de devenir professeure de yoga.
Muriel : C’est ce que tu décris très bien dans ton livre. Tu as d’abord eu besoin de t’ancrer, de retrouver une forme de stabilité. Et quand tu es devenue professeure de yoga, naturellement, tu t’es demandé : dans quelle mesure je peux aider mes filles grâce au yoga ?
Pour réaliser cette interview, j’ai aussi posé des questions à mon audience (j’ai reçu 90 réponses). Une maman d’un enfant autiste Asperger de 17 ans m’a écrit :
“Pour moi, le yoga a été une solution personnelle pour me renforcer, mais j’ai eu du mal à le transmettre à mon fils, car je ne savais pas comment faire et j’étais moi-même épuisée.”
C’est ce que tu vas offrir aujourd’hui à nos lecteurs : des clés pour accompagner les publics neuroatypiques.
Quand on enseigne le yoga, est-il important d’avoir un diagnostic de TSA ou de TDAH ?
Observer avant d’étiqueter : comprendre les besoins sensoriels de l’enfant
Jenny : En fait, ce qui nous intéresse, ce n’est pas tant de savoir si le diagnostic a été posé, mais plutôt quelles sont les manifestations que nous, professeurs, allons rencontrer chez nos élèves et comment y faire face.
Ça m’est arrivé plein de fois d’aller, par exemple, dans des centres de loisirs ou dans des écoles, avec un public qu’on dit “neurotypique”. Ce n’est pas forcément un public avec autisme ou TDAH, mais parmi ces enfants, il y en aura peut-être qui sont diagnostiqués… et d’autres non.
L’idée, c’est de pouvoir répondre aux besoins de chacun, peu importe qu’il y ait un diagnostic ou pas.
Je vais prendre un exemple : dans un centre de loisirs, un petit garçon de trois ans ne parlait pas. Il venait beaucoup en contact avec moi, différemment des autres enfants. Les autres restaient sur leur tapis, lui venait me voir, m’attrapait la jambe, me serrait fort, puis repartait jouer.
J’ai reconnu chez lui un besoin de compression, un besoin sensoriel que j’avais déjà observé chez ma fille autiste. Alors j’ai changé mon plan de séance et décidé qu’on allait s’enrouler dans nos tapis. Personne ne s’en est rendu compte, mais cet enfant, une fois contenu, s’est mis à rire et a dit : “Je suis tout serré !”
L’animatrice m’a confié ensuite que c’était la première fois qu’elle entendait sa voix.
Je ne sais pas s’il était autiste ou TDAH, mais ce n’était pas la question. Ce qui compte, c’est d’observer les besoins sensoriels et d’y répondre.
Est ce que cet enfant a un besoin sensoriel sur le moment ? Oui et du coup, grâce à ce que j’explique dans le livre, on peut reconnaître les besoins sensoriels et y répondre.
Ça ne m’appartient pas de savoir s’il a un diagnostic ou pas.
La reconnaissance des besoins sensoriels : exemple d’un enfant bruyant
Pour moi, le diagnostic n’est ni négatif ni positif. Il peut être une clé de compréhension, une reconnaissance, mais il ne doit pas devenir une étiquette qui enferme. L’essentiel, c’est de comprendre pour mieux accompagner.
Ça m’est déjà arrivé aussi d’observer un autre enfant en crèche qui faisait beaucoup de bruit. Les éducatrices ne savaient pas comment gérer cette situation, car il faisait vraiment beaucoup de bruit, sans qu’on comprenne pourquoi.
Là encore, j’ai cherché à répondre à ses besoins sensoriels. Et j’ai pu, en même temps, accompagner le personnel en leur expliquant pourquoi cet enfant pouvait réagir ainsi : quelles étaient les pistes possibles, les questions à se poser, et comment, au sein de la crèche, elles pouvaient mettre en place des ajustements simples.
L’idée, c’est vraiment de ne pas coller une étiquette qui risquerait de desservir l’enfant.
Mais, comme je l’explique aussi dans le livre, pour moi, le diagnostic a été une forme de reconnaissance. Ce n’est ni négatif ni positif : il ne faut simplement pas s’y enfermer.
Une étiquette peut permettre de mieux comprendre… et donc de mieux répondre à un besoin.
Muriel : Oui, et dans ton livre, la principale découverte pour moi, qui connais mal ces sujets, a été de découvrir ce yoga de la sensorialité, ce yoga des huit sens comme tu le nommes. Et, à l’inverse, si tu as un diagnostic, est ce que ça change ta manière de transmettre?
Adapter sa transmission selon les besoins et la sensorialité
Jenny : En fait, si, ça change un peu, oui.
Si je sais que je vais intervenir auprès d’un public spécifique, par exemple dans un centre de répit où les enfants séjournent quelques jours, on me transmet toujours un petit compte rendu : l’âge, le diagnostic, les sensibilités — tel enfant n’aime pas le son, un autre adore l’eau, etc.
Ces informations m’aident à construire ma séance en fonction de la sensorialité de chaque enfant.
C’est aussi important quand je reçois des familles dans mon studio de yoga. Si un diagnostic est connu, je vais être encore plus attentive à la sensorialité. Par exemple, je ne vais pas forcément proposer immédiatement à un enfant avec autisme d’intégrer un groupe parent-enfant.
Mais si je vois que le lien social, la manière de se comporter dans le groupe et la façon de vivre le yoga sont compatibles, alors oui, je l’intègre volontiers à un groupe d’enfants neurotypiques.
Ce qu’on cherche, c’est justement de cultiver le lien social et d’encourager chacun à trouver sa place dans un climat de bienveillance et d’acceptation de son unicité.
Donc oui, le diagnostic peut aider : il donne quelques clés pour poser les bonnes questions, mais ce n’est jamais une finalité.
L’important reste toujours d’observer, d’écouter, et de s’adapter.

Autisme et TDAH : faut-il proposer un cadre inclusif ou des cours de yoga dédiés ?
Muriel : Il y a eu énormément de questions sur ce sujet : faut-il proposer un cadre inclusif avec un enfant qu’on accueille dans un cours collectif, ou bien des cours spécifiquement dédiés ? Quels sont, pour toi, les critères qui permettent de décider qu’il faut proposer autre chose — parce que le cours collectif n’est pas adapté ?
Adapter sans exclure : rechercher le bénéfice pour tous
Jenny Leclerc : En fait, ce que je peux partager, c’est ma propre approche.
Ce qu’on veut avant tout, c’est que tout le monde puisse tirer un bénéfice de la séance de yoga.
S’il y a un enfant autiste qui crie beaucoup, fait beaucoup de bruit, ou un enfant TDAH qui bouge dans tous les sens et qu’il devient difficile à canaliser, le bénéfice pour le groupe peut être compromis.
C’est dommage, parce que ces enfants qui ont des besoins particuliers — je ne dirais pas qu’ils ont plus besoin de yoga que les autres —, mais ils ont des besoins pour lesquels le yoga peut être particulièrement bénéfique.
À ce moment-là, si l’inclusion dans un groupe est difficile, même temporairement, on peut envisager un accompagnement individuel ou un format différent, le temps que l’enfant puisse rejoindre un groupe plus sereinement.
Construire un espace bienveillant et adaptable
Jenny Leclerc :
Il y a aussi d’autres situations, comme dans les séjours répit, où chaque enfant a ses particularités.
Dans ces contextes, il y a plusieurs accompagnateurs pour plusieurs enfants, ce qui me permet d’assurer le cours tout en sachant qu’un adulte bienveillant pourra intervenir si un enfant a besoin de sortir, de s’isoler ou fait une crise.
Ça rend possible un cadre collectif avec des besoins différents.
En revanche, quand je suis seule à enseigner, je ne peux pas maintenir le cours et répondre en même temps à tous les besoins spécifiques. C’est là qu’intervient la question d’adaptation : elle est essentielle, mais elle demande de comprendre les mécanismes qui se cachent derrière chaque comportement et derrière chaque diagnostic.
C’est cette compréhension-là qui rend le yoga inclusif possible — pas le format du cours, mais l’intention et la bienveillance qu’on y met.
Enseigner le yoga : s’adapter aux comportements dits « à problème » des neuroatypies
Gérer l’impulsivité et les interruptions dans le cours de yoga
Muriel : La principale frustration de mon audience de professeurs de yoga, c’est de savoir comment gérer l’impulsivité et les interruptions pendant un cours. Je vais te lire quelques témoignages : une professeure me racontait qu’elle avait eu une petite fille de sept ans que sa grand-mère avait laissée sans explication. La fillette bougeait beaucoup et perturbait le reste du groupe. Que faire pour qu’elle ne perturbe pas les autres et que la séance puisse continuer ? Une autre prof parlait d’un élève qui hurlait pendant toute la séance, avec sa maman présente, et cela l’a mise très mal à l’aise. Comment poser une limite juste tout en restant dans la bienveillance ?
Jenny : Il n’y a pas de formule magique, pas de recette. Ce que j’ai observé, c’est qu’on arrive parfois dans un groupe avec un enfant dont on sent tout de suite que ça va être difficile, parce qu’il accapare toute l’attention.
Dans le cas de la petite fille déposée par sa grand-mère, par exemple, s’il n’y a pas d’autre adulte pour aider, il faut quand même que je garde le fil du cours. Alors, je cherche comment intégrer l’enfant plutôt que de le mettre à part. Si je sens qu’elle a besoin de prendre toute la place, je peux la rapprocher de moi, déplacer son tapis, lui proposer de devenir mon assistante. Cela lui donne un rôle et me permet de garder la dynamique du groupe.
Poser un cadre clair et bienveillant
Poser le cadre dès le début du cours est essentiel. J’explique toujours ce qu’on va faire : on va jouer, s’amuser, mais cela ne veut pas dire faire n’importe quoi. On a le droit de ne pas avoir envie de faire quelque chose, dans ce cas on reste sur son tapis ou on choisit une autre posture. L’important, c’est de respecter le groupe. J’aime bien demander ensuite : est-ce que tout le monde est d’accord ? On lève la main. Cet accord crée déjà une forme d’engagement collectif.
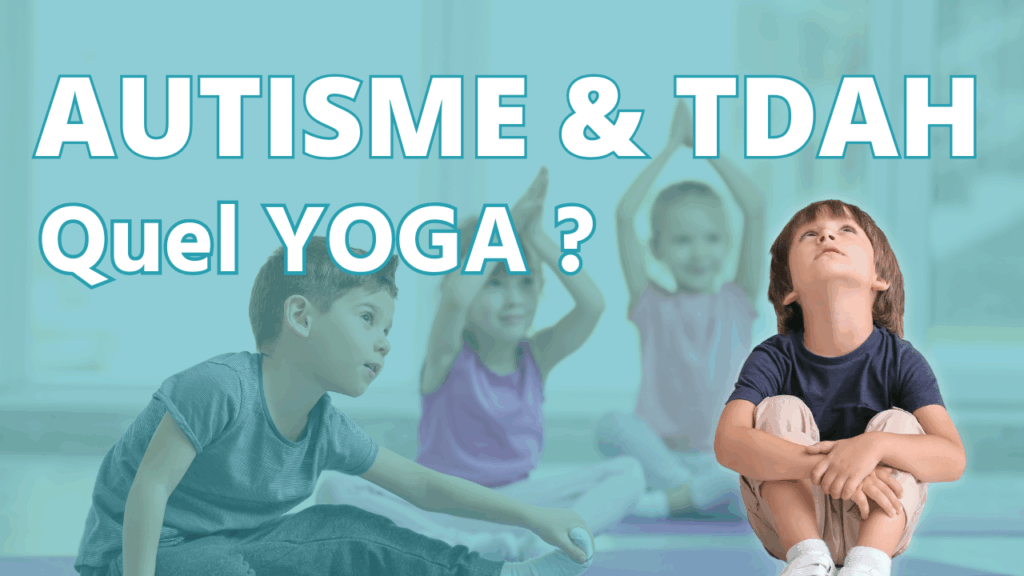
Chercher la cause d’un comportement
Dans le cas de l’enfant qui crie, c’est important de chercher à comprendre pourquoi. Parfois, il est là parce qu’un parent a insisté pour qu’il vienne, mais lui n’a pas envie. Et comme il ne peut pas le dire autrement, il crie. Dans ces cas-là, on peut lui laisser la possibilité de sortir ou de ne pas participer. L’idée, c’est d’observer ce qui se joue.
Il peut aussi y avoir des raisons sensorielles. Un enfant hypersensible au bruit peut se sentir agressé par les sons du groupe. Et que fait-on quand un bruit nous dérange ? On en fait un autre, plus fort, qu’on contrôle. Crier, c’est peut-être sa manière de se protéger.
Il arrive aussi que l’enfant ait associé un cri à une récompense : il obtient un câlin, l’attention du parent. Alors, il répète ce comportement. C’est une façon d’interagir.
Gérer la présence des parents
Quand on se retrouve dans cette situation avec le parent présent, il faut que chacun garde son rôle : le parent peut accompagner l’enfant si besoin pour que le cours se poursuive. Et si l’enfant reste en retrait, se cache derrière un rideau ou ne fait pas la séance, ce n’est pas grave. Je dis toujours : laissons-le tranquille. Peut-être qu’il observe. Souvent, la fois suivante, il revient et il fait.
Répondre aux besoins sensoriels de manière ludique
Avec des enfants très jeunes, parfois, il y a aussi des besoins sensoriels liés au son ou au contact. Par exemple, un petit garçon tapait très fort des pieds dès qu’on faisait les jambes au mur. Il riait, faisait du bruit, et prenait toute la place. Je ne pouvais plus continuer mon cours, alors je me suis calée sur lui : “Ok, tu tapes des pieds ? On va faire l’éléphant !” Tout le groupe s’est mis à marcher en tapant des pieds. On a répondu à son besoin de bruit, de stimulation proprioceptive, et tout le monde a pu continuer la séance dans la bonne humeur.
Souvent, après coup, je découvre que ces enfants recherchent toujours les jouets qui font du bruit, qu’ils les arrachent des mains des autres pour produire eux-mêmes le son. Leur comportement n’est pas un problème : c’est une réponse sensorielle. Et c’est pour cela qu’il faut observer avant de juger.
Accueillir l’expérience et se détacher du résultat
Muriel :
Et c’est compliqué parce qu’à cet âge là, tu n’as pas d’échange verbal possible, tu n’as que le test ! On voit donc qu’il faut beaucoup d’expérience, de curiosité, d’adaptabilité quand on donne ces cours !
Jenny : Je vais reprendre ce que tu as dit en tout début, tu donnais l’exemple de cette maman qui était prof de yoga et qui ne savait pas comment l’amener vers son fils. Moi, c’était un peu la même chose. J’avais appris à devenir prof de yoga, à enseigner à des adultes, à gérer un groupe, à maintenir leur attention. Mais je ne savais pas encore vraiment comment faire avec des enfants, et encore moins avec mes propres enfants.
Au début, j’étais dans une posture très “c’est moi la prof !”. Comme c’étaient mes enfants, je n’avais pas le même ton que j’aurais eu avec un groupe d’élèves qui ne me connaissaient pas. J’essayais de poser un cadre pour qu’ils m’écoutent, mais je me rendais compte que ce n’était pas si simple.
Ma clé à moi, ce qui a tout changé, c’est que, en tant que parent et aidante, j’ai pu suivre des formations sur l’autisme. Ces formations m’ont permis de comprendre et de gérer différemment les comportements qu’on appelle “à problèmes”. Par exemple, crier. Il faut bien mettre des mots : crier, c’est un comportement problème. Et la vraie question devient : qu’est-ce qui fait que l’enfant se met à crier ? Qu’est-ce qu’il obtient après avoir crié ?
C’est là que j’ai découvert la sensorialité. Elle faisait partie de ces formations et cela a été une véritable révélation. Je me suis dit : Mais oui, bien sûr ! J’avais déjà suivi une formation pour enseigner le yoga aux enfants, qui abordait la sensorialité, mais là, le fait d’être formée pleinement à ce sujet a tout changé.

Gérer la frustration d’enseignant ou de parent
Cela m’a permis de relier mes connaissances de prof de yoga avec ma réalité de mère et de comprendre en profondeur ce qui se joue derrière un comportement.
Jenny : Cette expérience vient avec le temps, l’observation, la remise en question. Au début, on tâtonne, on teste, on échoue parfois, puis on ajuste. Il ne faut jamais se dire que c’est un échec : chaque situation nous apprend quelque chose. Cela marchera mieux la prochaine fois, en essayant autre chose…ou pas !
Les parents aussi font du mieux qu’ils peuvent, tout comme les enseignants et les enfants eux-mêmes. Chacun fait de son mieux avec ce qu’il a, là où il en est. Et le yoga nous rappelle justement cela : on se détache du résultat, on apprend à accueillir.
Autisme et TDAH : chaque graine semée compte
Muriel : Exactement ! Ton ouvrage soulève beaucoup la question du sens de la pratique. En fait, pourquoi je pratique le yoga ? Avec ton approche, on est sur quelque chose de beaucoup plus ludique, avec plus d’accessoires, et surtout très axé sur les sens. J’ai trouvé cela vraiment différent du yoga pour adultes.
Jenny : Oui, c’est vraiment semer des graines. Et c’est aussi pour ça que je dis qu’on n’est pas obligé d’être professeur de yoga. Si, dans le livre, on fait une petite détente – il y a d’ailleurs une photo d’une maman qui détend son enfant –, et qu’on la refait une fois, deux fois, trois fois, on entraîne l’enfant à réussir à se détendre.
Ce sont autant de petites réussites qui, même à travers une seule posture, permettent à l’enfant de tracer un chemin neuronal vers la détente. Et cette capacité à se détendre, il la réutilisera dans plein d’autres situations de sa vie.
Muriel : Oui, et je dois dire que le livre s’adresse exceptionnellement bien aux familles. Il est magnifiquement illustré : les photos font rêver, les accessoires donnent envie, et tes explications sont simples, ludiques, faciles à comprendre. Cela parle autant aux parents qu’aux professeurs de yoga qui n’ont pas encore l’habitude du yoga pour enfants.
D’ailleurs, parmi mes lecteurs, plusieurs ont posé des questions sur l’anxiété que certaines postures peuvent déclencher.
Comment adapter les postures pour les enfants autistes ou TDAH ?
Anticiper l’anxiété et adapter les postures
Muriel : Certaines postures déclenchent des crises et laissent les enseignants de yoga stupéfaits. Alors, comment anticiper ces crises ? Comment faut-il adapter la posture ? Faut-il la faire quand même ?
Jenny : Dans ma pratique, je ne forcerai jamais à faire une posture quand je vois que ça ne va pas. On ressort, tout simplement. C’est valable aussi avec le public adulte.
Je reçois parfois ici des personnes en situation de handicap, et je ne sais jamais à l’avance ce qui va marcher pour elles. Ce qui a fonctionné pour la personne d’avant ne fonctionnera pas forcément pour la suivante. À chaque fois, on essaye, on observe, on n’est jamais obligé. Le cadre est posé dès le début : chacun fait selon ses possibilités et ses ressentis.
Comprendre les sources d’anxiété et proposer des adaptations
Ce qui peut rendre une posture anxiogène est souvent lié à la proprioception, à la capacité de ressentir son corps dans l’espace. Certains enfants ont la sensation de ne pas bien sentir leur corps, comme s’il leur échappait. Imaginez : on vous demande de tenir une posture d’équilibre, mais vous ne ressentez pas vraiment votre corps. Forcément, cela crée de la frustration, voire de l’anxiété.
Muriel : oui, même une posture en apparence simple, comme une fente ou un guerrier, peut alors devenir difficile. Ces postures demandent une stabilité qu’on ne mesure pas toujours quand on enseigne aux adultes, mais qui devient évidente quand on travaille avec des seniors.
Jenny : oui, Autisme et TDAH font partie de la grande famille des troubles du neurodéveloppement : on y retrouve aussi la dyslexie, la dyspraxie, etc. Il n’est donc pas rare que les enfants concernés aient aussi des troubles de la motricité.
Je conseille d’utiliser des supports : blocs, murs, objets familiers. Pratiquer à côté d’un mur aide beaucoup. Et puis il y a aussi la fatigabilité : certaines postures deviennent trop exigeantes pour l’enfant, qui a juste besoin d’être au sol.
S’il veut faire l’arbre en étant allongé, il s’allonge sur son tapis et il imagine qu’il fait l’arbre. Il le vit différemment, mais l’expérience est là, adaptée à son besoin du moment.
Être présent, sécuriser et valoriser
Ce qui est le plus important, c’est la présence. Être là, accueillir, accompagner, mettre en confiance. Dire simplement : “Fais ce que tu peux, je suis là.”
L’enfant doit sentir qu’on est avec lui, pas dans l’attente d’un résultat.
Et après la posture, on valorise : “Wouah, c’est super ! Tu as réussi à rester deux respirations, bravo !”
Peut-être que la fois précédente, il n’avait tenu qu’une respiration, ou qu’il avait pleuré. Là, il a progressé, il a réussi.
Cette reconnaissance des petites victoires est essentielle. Elle crée un lien, encourage la confiance, et aide à apaiser ce public d’enfants qui a besoin avant tout de se sentir compris et accompagné.
Comment réagir à une crise émotionnelle ou sensorielle pendant un cours de yoga ?
Comprendre ce qui a déclenché la crise
Muriel : Et au niveau des crises, si jamais on voit qu’une posture en déclenche une, est-ce qu’il y a une manière de réagir ? Que faire dans les premières secondes, pour calmer la crise et rassurer le groupe ?
Jenny : Quand une crise arrive, on ne sait jamais à l’avance quel va être le besoin de l’enfant.
Il m’est arrivé d’être en centre de loisirs, avec tous les enfants alignés sur leurs tapis — j’aime bien cette disposition les uns derrière les autres, même si on fait parfois des rondes. Ce jour-là, on faisait le serpent : les enfants naviguaient d’un tapis à l’autre.
Je n’avais pas été prévenue de quoi que ce soit, peut-être même qu’il n’y avait pas de diagnostic connu. Et soudain, je remarque qu’un enfant que je n’avais pas repéré comme ayant des besoins particuliers se retrouve au centre de tous les serpents, complètement arrondi, les mains serrées contre lui, en train de se balancer.
À ce moment-là, je comprends qu’il est en train de s’autoréguler, qu’il ne faisait pas cela avant, et que l’environnement vient de déclencher chez lui un besoin de régulation.
Mais je ne sais pas s’il va accepter que je le touche, que je lui parle, ou que je l’aide.
Alors, plutôt que d’intervenir directement, j’ai simplement fait revenir tous les serpents à leur place, calmement, comme si de rien n’était. Nous nous sommes assis, et l’enfant s’est arrêté de lui-même.
Modifier l’environnement pour calmer la crise
Quand une crise arrive, la première question à se poser, c’est donc : qu’est-ce qui l’a déclenchée ?
Si c’est l’environnement — trop de bruit, trop de mouvement, trop de proximité — alors il suffit souvent de modifier cet environnement pour que la crise s’apaise d’elle-même.
Ensuite, si on connaît l’enfant, tout devient plus facile.
C’est là qu’avoir un diagnostic ou des informations préalables peut aider : savoir s’il est gêné par le bruit ou au contraire s’il l’aime, s’il a besoin du contact physique pour se sentir en sécurité, ou si cela le dérange.
Toutes ces données permettent de préparer la séance en amont, d’anticiper les réactions possibles et, parfois, d’éviter que la crise n’apparaisse.
Et si elle arrive malgré tout, on sait mieux comment réagir, avec moins d’intervention et plus d’observation.

Comment formuler les consignes auprès d’enfants autistes ou TDAH ?
Adapter la manière de formuler les consignes
Muriel : J’ai aussi reçu beaucoup de questions sur la manière de formuler les consignes auprès de ces publics neuroatypiques.
Jenny : Ce qu’on sait, c’est que, notamment pour les enfants avec autisme, la parole demande énormément d’énergie.
Avec la fatigabilité, plus on parle, plus on sollicite leur attention et leur concentration, et plus on leur demande d’effort.
Dans un groupe où il y a un enfant autiste ou TDAH, il est souvent préférable de moins parler et de simplifier les consignes. On peut, par exemple, se contenter de donner des mots-clés au lieu de phrases complètes.
Plutôt que de dire : “On lève les bras, on met les mains, on s’étire, on se grandit, on se grandit, on se grandit, et puis on vient sur le côté”,
on dira simplement : “Bras vers le haut… côté.”
C’est clair, court, et cela laisse à l’enfant le temps d’intégrer la consigne avant de réagir.
Souvent, il y a un décalage entre l’écoute et la réponse, un temps d’intégration. L’enfant entend la phrase, mais il a besoin d’un moment avant que son corps réponde.
Si entre-temps on a déjà donné deux autres consignes, il est perdu, et il se fatigue rapidement.
Simplifier, démontrer et visualiser
Il ne faut pas avoir peur d’utiliser un ton très simple, presque maternel : “Mains en haut”, “Bras sur le côté”, “Debout”, “Assis”.
Juste des mots, pas de phrases.
Et surtout, démontrer : montrer la posture vaut parfois mille mots.
J’utilise aussi des images ou des cartes de yoga. Pour certains enfants, c’est rassurant de savoir à l’avance ce qui va se passer.
On peut leur montrer la série de postures : “Voici où on en est, après on fera celle-là.”
Cela les aide à se repérer dans le temps, à savoir quand la séance va se terminer.
Certains enfants ont besoin de visualiser la progression pour rester engagés.
Et parfois, il n’est même pas nécessaire de parler : il suffit de se taire et de montrer.
Cette simplicité dans la communication crée un espace plus calme, plus sûr, où l’enfant peut se concentrer sur ce qu’il ressent, plutôt que sur ce qu’il doit comprendre.
Autisme et TDAH : Quelle attitude adopter avec les familles ?
Accueillir les familles avec bienveillance
Muriel : Et avec les familles, quels mots ou attitudes adopter pour ne pas blesser, et comment accueillir au mieux le parent et son enfant ?
Jenny : Pour moi, on est ici dans une approche profondément yogique de la compassion. Il s’agit simplement d’être dans l’accueil, sans jugement.
Laisser au parent la possibilité de parler avant la séance, s’il en ressent le besoin. Parfois, il va vouloir partager quelque chose pendant la pratique, ou au contraire rester silencieux.
Notre rôle, c’est de rassurer : dire “C’est ok, c’est normal, ça peut se passer comme ça.”
À la fin de la séance, il y a parfois chez le parent une frustration ou une déception.
Parce qu’en tant que professeur, on voit des choses qu’un parent ne voit pas toujours.
Le parent peut repartir en pensant : “Cette séance n’était pas pour lui, il est resté caché derrière le rideau.”
Alors que, moi, j’ai vu un enfant observateur, à l’écoute, peut-être déjà en train d’intégrer la pratique. Et souvent, c’est cet enfant-là qui, plus tard, va refaire chez lui ce qu’il a observé.
J’ai eu une maman qui m’a amené son fils TDAH, un petit garçon qui bougeait beaucoup et dont l’école ne savait plus que faire. Il était passionné par Sonic, le petit hérisson bleu.
Je me suis donc appuyée sur cet univers-là : “Et si on faisait comme Sonic ? Sonic qui fait la posture de l’enfant, Sonic qui se met en boule…”
À partir de là, l’enfant est entré dans la pratique.
Ce que je veux dire, c’est qu’il faut aussi rassurer les parents.
Leurs enfants vivent dans un système qui les cloisonne beaucoup : ils doivent sans cesse rentrer dans des cases, alors qu’être soi-même, pour eux, c’est déjà un défi.
Le yoga peut justement offrir cet espace de liberté.
Et il faut rappeler aux parents que tout se fait un pas après l’autre, que chaque progrès compte, et que c’est en continuant avec patience et douceur que les résultats apparaissent.

Le yoga parent-enfant : créer du lien et semer des graines
Muriel : Et toi, tu pratiques souvent le yoga parent-enfant ?
Jenny : Oui, beaucoup. J’ai commencé par animer des séances hebdomadaires pour les enfants, puis j’ai travaillé en centre de loisirs, en crèche, avec tous les âges.
Aujourd’hui, je me consacre davantage au yoga parent-enfant, parce que c’est une formule que j’aime énormément.
C’est une pratique qui renforce le lien, qui sème des graines de complicité et de confiance.
Une posture apprise ensemble — la grenouille, la chauve-souris, les jambes au mur — peut être refaite à la maison. Et c’est là que la magie opère : le yoga devient un rituel partagé, une manière de se retrouver dans le calme et la joie.
Cette pratique, je la propose aussi bien pour les enfants neurotypiques que neuroatypiques.
Le plus important, c’est le lien, pas la performance.
Comment ajuster l’enfant avec un toucher éthique ?
Muriel : Alors Jenny, j’en viens à la question sur les photos. Je dois te dire que lorsque j’ai découvert ton livre, j’ai été frappée par la beauté des images. On y voit cette relation mère-fille, cette intimité dans le contact physique, cette complicité dans la posture.
Mais quand il s’agit d’un enfant qui n’est pas le nôtre, comment ajuster ? Comment stimuler au niveau du toucher tout en restant dans un toucher éthique ?
Jenny : Cela dépend beaucoup de la lignée de formation du professeur.
Dans ma formation, on va au contact seulement au dernier moment, c’est-à-dire lorsqu’on a montré, expliqué et qu’il y a besoin d’un réajustement sécuritaire.
Et même à ce moment-là, on demande toujours la permission : “Est-ce que je peux te toucher ?”
Ce n’est qu’après avoir reçu l’accord que le contact se fait.
Pour ma part, il est exceptionnel que je réalise ce type de posture à deux avec des enfants qui ne sont pas les miens. En revanche, entre enfants, si les deux sont d’accord, c’est tout à fait possible.
On peut profiter d’un duo pour travailler la confiance mutuelle : un enfant un peu plus grand se place en dessous, l’autre au-dessus, et l’on explore l’équilibre et la confiance ensemble.
En tant que professeure, par professionnalisme et par respect, je ne vais pas au contact physique direct avec les enfants des autres.
Et c’est aussi pour cela que j’aime tant le yoga parent-enfant : parce qu’il permet de retrouver ce lien corporel, cette intimité bienveillante, dans un cadre sûr et respectueux.
Il m’est arrivé qu’une maman me confie, lors d’une conversation en dehors du cours, qu’elle vivait une profonde détresse.
Son enfant, autiste, refusait tout contact. Pour elle, ne pas pouvoir toucher son enfant était extrêmement douloureux.
Ce n’est pas le cas de toutes les familles, bien sûr, mais c’est une réalité pour certaines.
Et c’est là que le yoga parent-enfant prend tout son sens : il offre un espace de rencontre douce, où l’enfant peut accepter le contact à son rythme, et où le parent apprend à laisser le choix à l’enfant.
Le respect du consentement, la patience et l’écoute font partie intégrante de cette approche du yoga.

Comment construire une séance adaptée aux besoins sensoriels de l’enfant ?
Construire une séance adaptée à la sensorialité de l’enfant
Muriel : Est-ce que, au niveau pratique dans ta séance, tu as des conseils à donner sur la durée des postures ? Est-ce que tu proposes plutôt des postures actives, passives, de détente ? Est-ce que tu les enchaînes rapidement ? Y a-t-il des règles ?
Jenny : Finalement, la seule vraie règle, c’est l’adaptation à ce qu’on observe.
C’est valable pour tous les publics, neurotypiques ou neuroatypiques.
Quand je construis une séance, je veille à mixer différents types de mouvements : des enchaînements dynamiques pour l’échauffement, puis des postures qui sollicitent différents systèmes sensoriels.
Je ne pense pas en termes de “postures debout, assises ou allongées”, mais plutôt en termes de stimulations sensorielles :
- Les postures qui travaillent le système vestibulaire, comme les inversions ou les salutations au soleil.
- Celles qui sollicitent la proprioception, le contact avec le sol ou avec le corps, pour aider à mieux se sentir dans l’espace.
- Et parfois, j’introduis le son, car il fait partie intégrante de la sensorialité.
Je me demande toujours : qu’ai-je fait en termes de toucher ? de proprioception ? de stimulation vestibulaire ?
C’est une grille de lecture sensorielle, plutôt qu’un plan figé.
Tenir compte des sens et des sensibilités
Je ne vais pas forcément utiliser tous les sens. Par exemple, le goût est difficile à explorer en séance, sauf dans un atelier spécifique.
Pour l’odorat, je sais que certains enseignants utilisent des huiles essentielles, mais je recommande la prudence.
Personnellement, je n’utilise aucun parfum ni déodorant fort lorsque je ne connais pas le groupe.
Les enfants, surtout ceux avec autisme, peuvent être très sensibles aux odeurs.
Il suffit d’un détail pour perturber toute la séance. Je me souviens d’une fois où j’avais lavé une petite balle de massage : une enfant l’a prise et m’a dit, spontanément, “Ah, mais ça pue ta balle !”
Elle ne disait pas cela pour blesser, c’était juste sa réalité sensorielle.
Organiser la séance comme une courbe douce
Je construis mes séances comme une courbe :
l’intensité monte progressivement au milieu, puis redescend vers des postures plus calmes et intégratives.
J’évite les séances trop “en M” — debout, puis au sol, puis de nouveau debout — car ces transitions répétées peuvent être trop stimulantes.
Je préfère un déroulé fluide, tranquille.
Et si, par exemple, au bout d’une seule posture debout, les enfants s’assoient déjà, ce n’est pas un problème.
Même si j’avais prévu deux postures supplémentaires, je m’adapte à leur état du moment.
Ce qui compte, c’est de rester à l’écoute.
Enfin, j’ajuste toujours selon l’âge des enfants : les plus jeunes ont besoin de variété et de rythme, les plus grands peuvent rester plus longtemps dans les postures.
C’est un équilibre à trouver entre mouvement, stabilité et ressenti.
Faut-il proposer des postures yeux fermés ou ouverts ?
Muriel : J’avais encore des questions très pratico-pratiques, mais on y a déjà un peu répondu. Par exemple : yeux ouverts ou yeux fermés ?
Jenny : Oui, belle question… et belle réponse de Normand : ça dépend !
Regardez quand vous enseignez à vos élèves adultes, même neurotypiques. Il y en a toujours certains qui gardent les yeux ouverts, même quand vous proposez de les fermer.
Fermer les yeux peut créer une insécurité, une anxiété, ou une perte de repères.
Donc, on peut le proposer — “Fermez les yeux si vous en avez envie” — mais si l’enfant ne veut pas, ce n’est pas un problème.
L’idée, c’est de laisser la liberté du choix : “Tu peux fermer les yeux si tu veux, ou regarder un point tranquille devant toi.”
Comment aborder Shavasana pour les enfants avec autisme ou TDAH?
Ce principe s’applique aussi à Shavasana, la posture de relaxation finale, allongé sur le dos.
Faut-il la proposer, la laisser de côté, l’adapter ?
Jenny : Pour moi, c’est comme tout le reste : on propose, on n’impose jamais.
Je dis simplement : “Voici ce que je vous propose. Si vous n’avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas.”

Je n’ai jamais vu d’enfant — autiste, TDAH ou non — refuser totalement Shavasana.
Parfois, ils en sortent plus tôt, parfois ils préfèrent la posture de l’enfant, ou les jambes au mur.
Tout est présenté dès le début, comme une palette de possibilités, et chacun choisit celle qui lui convient.
L’essentiel, c’est de rappeler que dans le yoga, on n’est jamais obligé de ne rien faire : c’est déjà une pratique en soi.
Quelle place donner aux pranayamas pour les publics neuroatypiques?
Le pranayama : rester simple et accessible
Muriel : Du coup, j’avais la même question pour le pranayama. Est-ce que tu le pratiques avec ces enfants ? Et est-ce que tu proposes des pranayama sonores, comme brahmari par exemple ?
Jenny : Oui, mais j’y vais simplement.
Je ne vais pas forcément vers des pratiques comme kapalabhati, qui font monter l’énergie du feu.
Avec les enfants, je préfère proposer des respirations abdominales, des respirations complètes, ou encore la cohérence cardiaque.
Certains ont déjà fait de la sophrologie ou d’autres approches de respiration, donc ils connaissent un peu.
Brahmari peut être intéressant, justement parce qu’il amène le son et la vibration, ce qui est une belle porte d’entrée sensorielle.
Mais globalement, j’évite les pratiques trop intenses, trop techniques, ou qui demandent un long temps de concentration.
Pour la durée, c’est pareil : je ne reste jamais très longtemps sur une respiration.
Encore moins avec un public d’enfants, ou même d’adultes TDAH.
On connaît les effets des pranayama : ils peuvent parfois faire remonter des émotions, ramener à la conscience des choses enfouies, et donc être déstabilisants.
Je préfère rester dans quelque chose de classique, doux et accessible.
Pas de respiration carrée, ni de pranayama très prolongé.
Tout dépend aussi de l’intention qu’on y met.
Mon intention, quand je propose un pranayama, c’est que les élèves repartent avec une ressource simple.
Qu’ils puissent l’utiliser dans leur quotidien — à l’école, au travail, face à un stress.
Et rien qu’une respiration abdominale, une respiration complète, c’est déjà énorme.
Peut-être que dans six mois ou un an, ma réponse évoluera.
Mais aujourd’hui, j’aurais envie de dire : prudence et simplicité avec les pranayama.
Les pranayamas avec les accessoires ou les mains
Et puis, j’ai une anecdote.
Je n’avais jamais montré kapalabhati à mes enfants.
Un jour, ma fille autiste est dans le salon.
Elle pose ses mains sur la table, les croise, et fait un mouvement de pompe avec les bras.
Je me dis : “Tiens, elle répond à un besoin sensoriel, elle stimule son corps.”
Et puis je remarque qu’à chaque fois qu’elle appuie, elle expire fortement : “pfff, pfff, pfff…”
Sans jamais l’avoir appris ni vu, elle reproduisait spontanément le mouvement de kapalabhati.
C’était fascinant.
Alors oui, on peut explorer le souffle, mais avec écoute et prudence.
Et pourquoi pas à travers des objets sensoriels — plumes, pompons, bâtons de pluie — qui permettent d’aborder le pranayama autrement, sans forcer le souffle ni la technique.
Le yoga, une clé pour les adultes TDAH
Jenny témoigne : le yoga peut véritablement apaiser le mental
Muriel : Pour conclure, je te remercie sincèrement pour ta générosité et la richesse de ton partage.
Je voudrais ouvrir un peu sur les adultes TDAH ou diagnostiqués tardivement. Dans ma génération, beaucoup ont été diagnostiqués bien plus tard.
Jenny : Le yoga me semble une clé formidable. On sème des graines chez nos enfants, mais il n’est jamais trop tard pour les adultes.
Et d’ailleurs, je crois que je n’en ai jamais vraiment parlé dans le livre ni sur les réseaux : je me reconnais moi-même dans le profil TDAH.
Je n’ai pas ressenti le besoin d’aller chercher un diagnostic officiel.
Mais attention à l’autodiagnostic — il ne s’agit pas de se coller une étiquette, simplement de mieux se comprendre.
S’il y a un témoignage que je peux faire, c’est que le yoga peut véritablement apaiser le mental.
On peut retrouver de la paix, de la clarté, de la sérénité, que ce soit à travers les postures ou une approche plus méditative.
C’est possible, même avec un TDAH, même avec un mental qui bouillonne.
Et comme le TDAH et le TSA font partie des troubles du neurodéveloppement, ils s’accompagnent parfois de comorbidités : anxiété, dépression, épuisement.
Le yoga devient alors un outil pour se reconstruire, pas à pas.
Adulte TDAH : pensez-vous que le yoga est impossible pour vous ?
Muriel : Merci pour ce message. C’est vrai que beaucoup d’adultes TDAH réagissent en disant : “Le yoga, ce n’est pas pour moi. Je ne pourrais jamais rester en place.”
Et toi-même, au début, tu disais ça aussi, non ?
Jenny : Oui ! J’y suis allée à reculons.
Mais je voyais bien que j’étais dans une impasse. J’ai commencé malgré mes réticences, et c’est devenu ma bouée de sauvetage.
J’ai pratiqué avec Maryse Lehoux, sur sa plateforme Diva Yoga.
Le yoga que j’ai découvert là m’a convenu parce qu’il était doux, bienveillant et accessible.
J’ai aussi pratiqué du yoga Iyengar, plus rigoureux et exigeant, pendant trois ans. J’en ai beaucoup appris, il me restait aussi beaucoup à apprendre, mais à un moment, ça ne correspondait plus à mes valeurs ni à mon chemin.
Je me suis donc construite ma propre manière d’enseigner, en lien avec la sensorialité.

Comprendre l’ayurvéda par la sensorialité
Et là, petite parenthèse pour les professeurs : si vous êtes TDAH, cela va vous parler.
Dans la logique ayurvédique, vous allez reconnaître des aspects Vata, Pitta, Kapha.
Vous remarquerez peut-être que certaines postures statiques au sol vous apaisent, alors que d’autres, en mouvement, vous déstabilisent.
C’est sans doute lié à vos besoins sensoriels, à votre système vestibulaire ou à votre hypersensibilité.
Encore une fois, il ne s’agit pas d’étiquettes, mais de mieux se connaître pour mieux adapter sa pratique.
Muriel : Et tu as réagi fortement quand j’ai parlé de ces adultes hyperactifs qui disent : “Non, le yoga, ce n’est pas pour moi.”
Jenny : Oui, parce que c’est un a priori énorme.
Souvent, ceux qui pensent ne pas pouvoir faire de yoga sont précisément ceux qui en ont le plus besoin.
Quand on dit “je ne peux pas rester tranquille”, c’est justement le signe qu’on a besoin d’apprendre à ralentir.
Mais attention, il ne s’agit pas de forcer.
Le yoga, ce n’est pas une injonction à la lenteur : c’est une invitation à l’équilibre.
Quand on vit dans l’extrême de l’agitation, on n’a pas besoin de basculer dans l’extrême opposé du silence total.
On peut y aller progressivement, à son rythme.
Beaucoup de gens, comme moi, ont eu besoin d’un électrochoc : burn-out, dépression, fatigue extrême. C’est souvent à ce moment-là qu’on se dit : “Je n’ai plus rien à perdre.” Et on essaie. Et souvent, c’est là que le yoga commence à faire sens.
Muriel : Merci, Jenny, vraiment, pour tout ce temps et cette générosité. Tu as partagé une mine d’informations précieuses.
Je suis certaine que cette interview suscitera beaucoup de réactions.
N’hésitez pas à poser vos questions à Jenny en commentaire !
Comment retrouver Jenny Leclec ?
Je rappelle le titre de ton ouvrage : “Yoga, Autisme et TDAH”, coécrit avec Maryse Lehoux.
On peut te retrouver sur ton site Yoga Santé Nature.
Ton choix de cœur, c’est d’accompagner les duos parent-enfant, et tu es installée en Normandie, dans l’Eure, près d’Évreux.
Et pour ceux qui se demandent, tu proposes aussi un accompagnement en ligne, plutôt sous forme de mentorat personnalisé, mais pas de cours de yoga en direct.
Jenny : Oui, exactement. C’est un accompagnement pour mieux vivre le diagnostic, qu’il soit le sien ou celui de son enfant.
Merci Muriel, de m’avoir laissé cet espace de parole, et merci à ton audience pour sa curiosité et ses questions.
Muriel : Merci à toi, Jenny, pour ton partage.
À bientôt !


